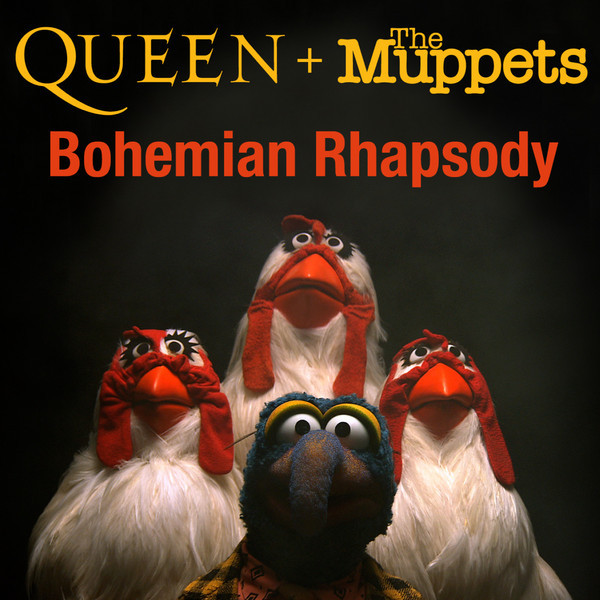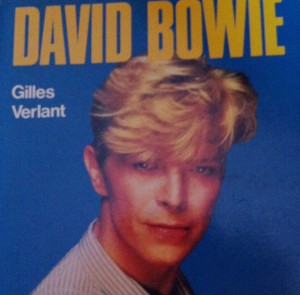Ceux qui me connaissent dans la vraie vie savent que je suis non-violente. Opposée à la peine de mort. Anti-fourrure, corrida et élevage industriel. Végétarienne. Je suis râleuse, négative, froide, névrosée, oui. Violente non, tant qu’on me fiche la paix. N’empêche qu’hier, j’ai failli tuer un DJ. Quoi qu’en disent ceux qui ont subi les éléments les moins glorieux de la profession lors de mariages et autres réjouissances, tuer un DJ, même le plus mauvais de tous, est un crime. Il serait même passible de prison. Heureusement que je ne sors jamais avec une machette au fond de mon sac. À cette heure, je devrais expliquer à Good Cop et Bad Cop que la victime a réveillé en moi un souvenir pénible.
Revenons sur les faits. Hier, je suis allée voir Damon Albarn à l’Alhambra. En prenant soin de ne pas arriver trop tôt, puisque le billet avertissait d’un DJ set de Rémi Kabaka. Ok, le gars a déjà travaillé avec Damon Albarn. C’était lui, Russell, le batteur balèse de Gorillaz, le meilleur groupe virtuel de tous les temps. Mais derrière des platines, l’individu le plus talentueux qui soit peut se muer en atroce pète-rouleaux.
A peine installée dans la mezzanine, j’ai senti que Rémi et moi n’allions pas être potes. Loin de sa batterie, ce garçon est dangereux. Il aime les gros beats. Répétitifs. Lancinants. Les bidouillages abstraits qui provoquent un triple orgasme chez ses confrères DJ, mais qui me laisse, moi, bête amoureuse de mélodies, indifférente, agacée, puis enragée. Je n’ai rien contre les DJ, j’en connais de très bien, je vous assure. Je n’ai rien non plus contre la musique électronique. Mon cerveau n’a juste pas été programmé pour apprécier des beats en boucles et des samples sans queue ni tête.
Me voilà donc condamnée à subir ce tortionnaire des platines. Si je me lève, comme je ne suis pas accompagnée, on va me piquer ma place, c’est sûr, j’en vois déjà qui louchent dessus. Comme il n’y a pas de réseau, je ne peux pas m’épancher sur les réseaux sociaux (faisant habilement savoir que tralala, je vais voir Damon Albarn après, lalalalère !). Je réalise que je n’ai pas installé Candy Crush ou n’importe quel autre match 3 addictif sur mon nouvel iPhone (oui, j’ai parfois de gros soucis de bobo-enfant-gâtée). Je regarde l’heure. Cinq minutes se sont écoulées depuis que j’ai posé mon séant sur ce fauteuil. Je fouille dans mon sac. Rien qui ne puisse me permettre d’abréger le supplice. Pas même une pince à épiler que je pourrais brandir en hurlant : “Rémi, lâche ces platines, sinon je te bousille sévèrement le sourcil droit !”
Soudain, violent choc intérieur. C’est le retour du refoulé. Je me revois, il y a quelques années aux Nuits Sonores à Lyon, missionnée par un quotidien pour lequel j’écrivais. Je devais passer la nuit dans une usine désaffectée où Jeff Mills et quelques autres mixaient. J’y étais allée avec l’enthousiasme de Dora l’exploratrice partant à l’aventure, décidée à vivre ça comme une expérience que je ne referais jamais. Effectivement. Un pied dans l’usine et j’ai eu le sentiment d’être dans un enfer taillé sur mesure pour moi. La poussière, accumulée depuis un quart de siècle au minimum, m’a attaquée, me condamnant à ne plus quitter mes Wayfarer, sous peine d’exhiber des yeux de grenouille albinos. Les WC débordaient, à moins que le raveur moyen ne se soulage en dansant. Et surtout, le bar ne servait pas d’alcool. Sous le prétexte douteux que le raveur préfère les energy drinks pour tenir toute la nuit. J’ai bu des choses étranges au cours de ma vie, y compris du vinaigre blanc et du produit vaisselle (pas volontairement, je précise), mais rien de pire qu’un Pepsi Black, mélange de Pepsi et de café, sentant la chaussette humide.
Évidemment, cette scène apocalyptique était baignée de pulsations sonores faisant vibrer le sol et de strobes à tuer une colonie d’épileptiques. Cette nuit-là, j’ai eu envie de tuer des DJ. D’autant qu’eux, ces pignoufs, avaient l’air de s’éclater comme des petits fous, affichant la mine ravie du clebs venant de se branler sur ta jambe quand ils relevaient le museau de leur console. Le temps semblait ne pas s’écouler. J’avais soif, j’étais cernée d’une nuée de zombies puant la sueur et le faux Red Bull. Lorsque la première navette vers le centre ville est arrivée, j’ai bondi dedans, préférant poireauter une heure dans une gare déserte plutôt que de moisir dans cet enfer. De retour à Paris, j’ai juré de ne plus jamais, jamais, jamais m’y laisser reprendre. Et j’ai enfoui ce souvenir dans ma mémoire. Jusqu’à hier.
Non, tu n’es pas revenue à Lyon, me disais-je. Bientôt, le méchant monsieur va lâcher ses platines et le gentil Damon va venir. La vision de Marianne Faithfull, se glissant à sa place, deux rangs devant moi, m’a tirée du cauchemar. J’étais bien à Paris. Que foutrait la divine Marianne à une rave, hein ? J’ai entendu des applaudissements saluant la fin du set de mon némésis. Était-ce du soulagement ? De la politesse ? M’en fous. Dix minutes plus tard, Damon Albarn est arrivé. Et au bout d’une 1h45 de concert, si on m’avait proposé de le revoir le lendemain, à condition de me beurrer à nouveau DJ Casse-Bonbecs, j’aurais dit oui.
En apportant un flingue ou un piège à ours, quand même, au cas où…